Tout commence avec une scie. Pas n’importe laquelle, une scie à chantourner. Au XVIIIe siècle, des cartographes européens découpent des cartes montées sur bois pour enseigner la géographie aux enfants de l’aristocratie. C’est là que naît le puzzle, dans les salons feutrés des familles royales, bien loin des compétitions de vitesse actuelles. Ce jeu éducatif évolue lentement, passant d’un outil pédagogique à un loisir grand public, en particulier pendant la Grande Dépression, où le puzzle devient un divertissement abordable, recyclable et intensément addictif.
Mais pour comprendre l’histoire du speed puzzling, il faut basculer dans une autre temporalité. Celle de la course contre la montre. Et cette idée simple — terminer un puzzle le plus rapidement possible — ne vient pas d’un fabricant de jouets, mais d’une femme du Midwest.
Betty McGregor, l’étincelle américaine
Minnesota, 1946. Betty McGregor, jeune mariée, adore organiser des soirées jeux. Son mari, moins fan de ces longues sessions de puzzle entre amis, propose un compromis : jouer, oui, mais avec une limite de temps. Betty pose une horloge sur la table. Sans le savoir, elle vient d’inventer un format qui traversera les décennies : le puzzle chronométré.
Chaque mardi, elle ouvre sa maison à des inconnus et des amis pour des duels de puzzles. La règle est simple : une boîte, un chrono, le silence se fait, puis les mains s’activent. C’est convivial, mais c’est aussi une compétition. Rapidement, le bouche-à-oreille fait son travail. D’autres familles imitent le format. Des petites compétitions s’organisent dans des cuisines, des garages, des centres communautaires. Le puzzle, longtemps perçu comme une activité contemplative, devient une épreuve de vitesse et de concentration.
L’évolution vers un sport
L’idée met du temps à percer hors des cercles amateurs. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que le speed puzzling sorte de l’anonymat. Les premiers tournois organisés apparaissent, modestes, mais structurés. Ce sont souvent des événements locaux, organisés par des bibliothèques, des clubs ou des écoles. Les règles se précisent : temps limite, puzzles de taille identique, interdiction de trier les pièces à l’avance. Le public est varié, intergénérationnel. Une grand-mère peut battre un adolescent, une mère de famille rivaliser avec un étudiant. Pas besoin d’un physique particulier, seulement d’un œil affûté, d’une mémoire visuelle redoutable, et d’un calme olympien.
Des marques de puzzles s’intéressent au phénomène. Ravensburger, Cobble Hill, Educa… Certaines commencent à sponsoriser des événements. Le marketing suit : on parle de « puzzle racing », de « jigsaw sports ». La discipline reste encore de niche, mais elle commence à tracer son sillon, en particulier dans les pays anglo-saxons.
La structuration internationale
C’est en 2019 que le tournant majeur a lieu avec la création de la World Jigsaw Puzzle Federation (WJPF). Son objectif : faire reconnaître les compétitions de puzzles comme un sport à part entière. Le projet est sérieux : standardisation des règlements, reconnaissance des records par le Guinness World Records, mise en réseau des fédérations nationales, organisation de championnats du monde.
L’ambition dépasse la simple performance : il s’agit aussi de valoriser les bienfaits du puzzle sur la santé cognitive, la socialisation et la concentration. Le puzzle n’est plus seulement une activité du dimanche pluvieux, c’est un terrain d’entraînement mental. Les compétitions officielles réunissent désormais des centaines de participants venus de dizaines de pays. Les formats varient : individuel, duo, équipe de quatre, en 500 ou 1000 pièces, avec des puzzles inconnus à découvrir en temps réel.
Un record du monde ? Compléter un puzzle de 500 pièces en moins de 30 minutes. C’est rapide, brutal, méthodique. Chaque mouvement est calculé. Les meilleurs speed puzzlers fonctionnent comme des athlètes : échauffement visuel, stratégies de tri éclair, zones de spécialisation (bords, couleurs, textures). Certains utilisent même des grilles mentales pour répartir l’image en secteurs à couvrir.
Pourquoi ça séduit ?
Le speed puzzling attire pour une raison simple : il transforme une activité solitaire en un défi collectif. Il combine le zen du puzzle traditionnel avec l’adrénaline du compte à rebours. Contrairement aux jeux vidéo ou aux sports physiques, il est accessible à tous. Pas besoin d’équipement cher ou de condition physique particulière. Tout ce qu’il faut, c’est une table, une boîte, et l’envie d’aller vite.
Et ce n’est pas qu’une question de gagner. Le vrai plaisir réside dans le flow : cet état mental où le cerveau est entièrement absorbé par une tâche, entre concentration extrême et perte de la notion du temps. Un bon speed puzzler n’est pas seulement rapide. Il est présent, ancré, entièrement là. L’épreuve devient presque méditative, une transe minutieuse.
En marge des compétitions officielles, des clubs naissent dans les grandes villes, des communautés se forment en ligne, des tutoriels circulent sur YouTube. Le speed puzzling devient une culture, avec ses héros, ses techniques, ses débats sur la meilleure méthode : trier par couleur ou par forme ? Faire les bords d’abord ou se jeter directement dans le centre ? Faut-il retourner toutes les pièces ou seulement certaines ? Rien n’est laissé au hasard.
Et maintenant ?
Le futur du speed puzzling semble tracé. En Espagne, aux États-Unis, au Japon, en France, des championnats nationaux s’organisent. Les compétiteurs voyagent. Les records tombent. Des enfants de 10 ans affrontent des retraités. Des influenceurs spécialisés émergent. Et certains rêvent même d’une place dans les Jeux olympiques des sports mentaux.
Mais au fond, peu importe les podiums. Ce qui compte, c’est l’intensité du moment, cette étrange excitation quand le chrono démarre, quand chaque pièce s’emboîte avec un claquement sec, quand les regards se croisent au-dessus du puzzle, entre complicité et rivalité.
Le speed puzzling est né dans une cuisine, avec une horloge. Aujourd’hui, il occupe des gymnases, des halls, des scènes de congrès. Mais son essence reste la même : assembler le chaos, vite, très vite — et savourer, pièce après pièce, le plaisir de remettre de l’ordre dans le monde.
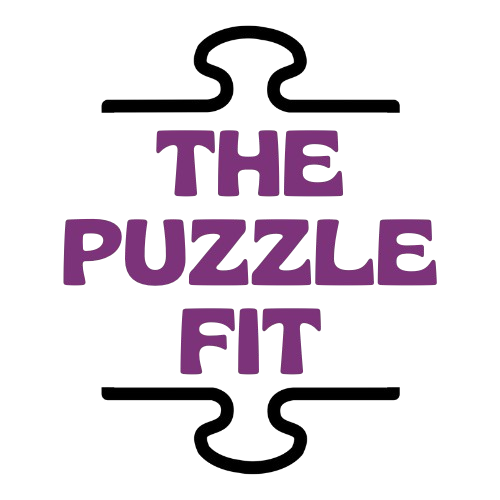

Laisser un commentaire